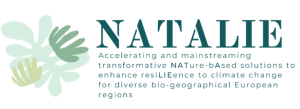- Changement climatique
- Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
- Innovation
- Usages et ressources en eau pour l'agriculture
SpongeScapes et SpongeWorks : deux projets européens innovants réunis à Toulouse pour lutter contre les impacts du changement climatique

Du 22 au 26 septembre 2025, la ville rose a accueilli les Assemblées Générales des projets européens SpongeScapes et SpongeWorks, deux initiatives phares financées par l’Union européenne pour développer des solutions fondées sur la nature face aux défis climatiques. Ces rencontres ont permis de dresser un bilan des avancées, de partager les premiers résultats et de définir les prochaines étapes pour rendre les territoires plus résilients.
Les « mesures éponges » : une réponse concrète au changement climatique
Prenant la suite d’un projet piloté par l’OiEau sur les Mesures Naturelles de Rétention d’Eau (MNRE), développé en 2013-2015 et enrichi avec le projet OPTAIN en 2020, les projets SpongeScapes et SpongeWorks se concentrent sur les « mesures éponges ». Il s’agit de solutions naturelles visant à ralentir le cycle de l’eau pour limiter les inondations, atténuer les sécheresses, et améliorer la biodiversité et la qualité des sols. Ces mesures incluent l’amélioration de la perméabilité des sols, la plantation de haies ou encore la restauration de zones humides.
Alors que SpongeScapes fournit les bases scientifiques, SpongeWorks se concentre sur la mise en œuvre à grande échelle.
Trois grands bassins versants européens ont été retenus pour devenir des démonstrateurs, dont la vallée de la Lèze. Située dans le sud-ouest de la France, la vallée de la Lèze (Ariège/Haute-Garonne) est devenue un laboratoire à ciel ouvert pour tester ces solutions et chercheurs, agriculteurs, collectivités et habitants y collaborent pour co-construire des scénarios de résilience.
Assemblées générales 2025 : bilan et perspectives
SpongeScapes : faire progresser la science vers des outils d’aide à la décision innovants
Deux ans après son lancement, le projet SpongeScapes a déjà apporté des contributions significatives :
- Mise à jour du catalogue des 51 mesures éponges et des 140 études de cas recensées par le projet MNRE, et ajout de nouvelles fiches, aboutissant à une revue critique des fonctions des éponges à travers l'Europe, identifiant à la fois les preuves et les lacunes dans les connaissances.
- Publication d'une série d'articles scientifiques sur des sujets allant du rôle de la végétation dans la rétention d'eau aux compromis entre inondations, sécheresses et biodiversité.
- Collecte de données hydrologiques : Les chercheurs ont présenté les résultats de deux années de monitoring, avec une modélisation avancée des impacts des mesures éponges.
- Développement d’un outil cartographique dit « cartes d’opportunité » permettant de montrer à large échelle les endroits les plus adaptés pour implanter des mesures éponge sur le territoire.
- Lancement de SpongeLabs, des ateliers participatifs, aux Pays-Bas et en France, où les parties prenantes co-conçoivent des scénarios d'utilisation des sols à l'aide d'un outil interactif, GeoDesign, pour visualiser l’impact des mesures éponges sur le territoire selon différents scenarios.
- Organisation de webinaires.
Prochaines étapes :
• Finalisation de l’outil de cartes d’opportunité.
• Finalisation de l’outil GeoDesign.
• Renforcement des liens entre science et action locale pour une mise en œuvre efficace.
SpongeWorks : passer de la science à l'action avec des solutions testées à grande échelle
Alors que SpongeScapes fournit la base scientifique, SpongeWorksse concentre sur la mise en œuvre à grande échelle.
Ses bassins de démonstration en France (bassin de la Lèze), en Grèce (bassin du Pinios) et à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas (bassin de la Vecht) testent l'efficacité pratique de différentes mesures d'éponges, avec le soutien de huit « régions associées » supplémentaires à travers l'Europe.
Dans la vallée de la Lèze, le projet a rassemblé près de 50 % des agriculteurs avec un financement dédié pour la mise en place de mesures éponges (plantation de haies, restauration de ripisylves, renaturation de ruisseaux, bassins d'infiltration, création / restauration de mares, restauration de zones humide).
Les 1ers résultats sont encourageant avec une réduction significative de l’érosion et des coulées de boue sur les parcelles équipées.
Un suivi scientifique rigoureux effectué en collaboration avec le CNRS permet d’évaluer l’efficacité des mesures.
Prochaines étapes :
• Traduction des résultats en modèles économiques pour quantifier les bénéfices socio-économiques (ex. : impact sur la santé des citoyens en milieu urbain).
• Extension des tests à d’autres régions européennes.
Vers une généralisation des solutions
Toutes les connaissances accumulées au cours des expérimentations de terrain seront rassemblées dans un catalogue de mesures et de retours d’expériences (études de cas) accessible sur la Sponge Knowledge Platform (le. spongescapes.eu), un site web partagé, disponible et pérenne.
En 2026, il est prévu la finalisation des outils de modélisation et la publication des résultats dans des revues scientifiques et des supports grand public.
En 2027, ces mesures éponges seront étendues à d’autres territoires européens, avec un accent porté sur les zones urbaines.
Tout au long des projets, une collaboration étroite entre SpongeScapes et SpongeWorks sera renforcer pour harmoniser les méthodes et maximiser l’impact.
Visualisez la visite du démonstrateur de la vallée de la Lèze