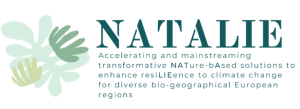- Changement climatique
- Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
- Eaux pluviales
- Hydromorphologie
- Inondation
L’atlas cartographique des bulletins de situation hydrologique : un outil pour comprendre et suivre l’eau en France

Depuis le 26 juin, un Atlas cartographique, disponible sur la toile eaufrance, complète les BSH (Bulletins de Situation Hydrologique), permettant une consultation facile des cartes des BSH mensuels nationaux des 10 dernières années.
Cet outil innovant démocratise l’accès aux données hydrologiques, en offrant une vision claire, historique et interactive de l’état de l’eau en France.
Deux questions à Sophie Comte, Coordinatrice du Pôle Information et Connaissance à l'OiEau, qui a piloté la création de cet outil, géré avec l'appui de l’Office français de la biodiversité (OFB).
Pourquoi un Atlas des Bulletins de Situation Hydrologique ?
En France, le Bulletin national de Situation Hydrologique (BSH) est publié chaque mois pour décrire l’état des ressources en eau sur le territoire métropolitain. Il rassemble des données sur les précipitations, les débits des cours d’eau, les niveaux des nappes souterraines, l’état des barrages, et bien d’autres indicateurs. Ces informations, bien que précieuses, sont souvent techniques et complexes à interpréter pour le grand public.
C’est dans ce contexte qu’a été créé l’Atlas cartographique des BSH, un outil visuel, interactif et accessible à tous.
Son objectif est triple :
- Faciliter la consultation des cartes des BSH des 10 dernières années, en offrant une vision synthétique et claire de l’évolution des ressources en eau.
- Permettre une analyse simultanée en observant plusieurs thématiques (sècheresse, eau souterraine, précipitations, etc.).
- Rendre accessible à la consultation du public (collectivités, professionnels, citoyens) les cartes essentielles pour la gestion de l’eau, sans remplacer le BSH, mais en le complétant.
L’Atlas s’inscrit dans une démarche de transparence et de valorisation des données publiques, en offrant un historique visuel et interactif des situations hydrologiques passées.
Comment utiliser l’Atlas ? Quelles fonctionnalités offre-t-il ?
L’Atlas cartographique des BSH a été conçu pour être simple, intuitif et efficace.
Voici comment l’utiliser :
- Sélectionner une période : L’outil permet de choisir une période continue ou discontinue sur les 10 dernières années, pour suivre l’évolution des indicateurs hydrologiques dans le temps.
- Choisir une thématique : Plusieurs thèmes sont disponibles (précipitations, niveaux des nappes, débits des cours d’eau, etc.). L’utilisateur peut afficher les cartes correspondantes à ses besoins.
- Visualiser et comparer : Les cartes s’affichent de manière dynamique, permettant de comparer les situations entre différentes périodes ou thématiques.
L’Atlas est particulièrement utile pour :
- Les collectivités et professionnels de l’eau, qui peuvent s’appuyer sur ces cartes pour la gestion des ressources ou la planification.
- Les citoyens, qui souhaitent mieux comprendre l’état des ressources en eau dans leur région ou en France.
- Les chercheurs et étudiants, pour qui l’outil offre une base de données visuelle et historique.
Un outil collaboratif et évolutif
L’Atlas s’enrichit régulièrement de nouvelles informations. Il ne remplace pas le BSH, mais le complète en le rendant plus accessible et plus visuel.
Pour découvrir l’Atlas des BSH, rendez-vous sur : http://www.atlas-bsh.fr .
Une collaboration entre plusieurs acteurs
Le Bulletin national de situation hydrologique (BSH national) est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office International de l’Eau (OiEau), en lien avec l’OFB et la Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique.
Les différents contributeurs au BSH :
• Météo-France pour les données météorologiques (précipitations, humidité des sols, manteau neigeux);
• les DREAL(1) de bassin et le service Vigicrues (ex SCHAPI (2)) pour les données sur les débits des cours d'eau et l'état de remplissage des barrages (en collaboration avec d’autres acteurs nationaux, comme EDF (3), VNF (4) et des EPTB (5) tels que Seine Grands Lacs et Loire) ;
• le BRGM pour les niveaux des nappes d’eau souterraine. Ces données sont produites a dix reprises au cours de l’année ce qui explique leur absence de certains bulletins ;
• l’Office français de la biodiversité (OFB) pour les observations sur les étiages (entre les mois de juin et octobre), et le soutien financier à la publication.
1 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
2 Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des crues
3 Électricité de France
4 Voies navigables de France
5 Établissement public territorial de bassin